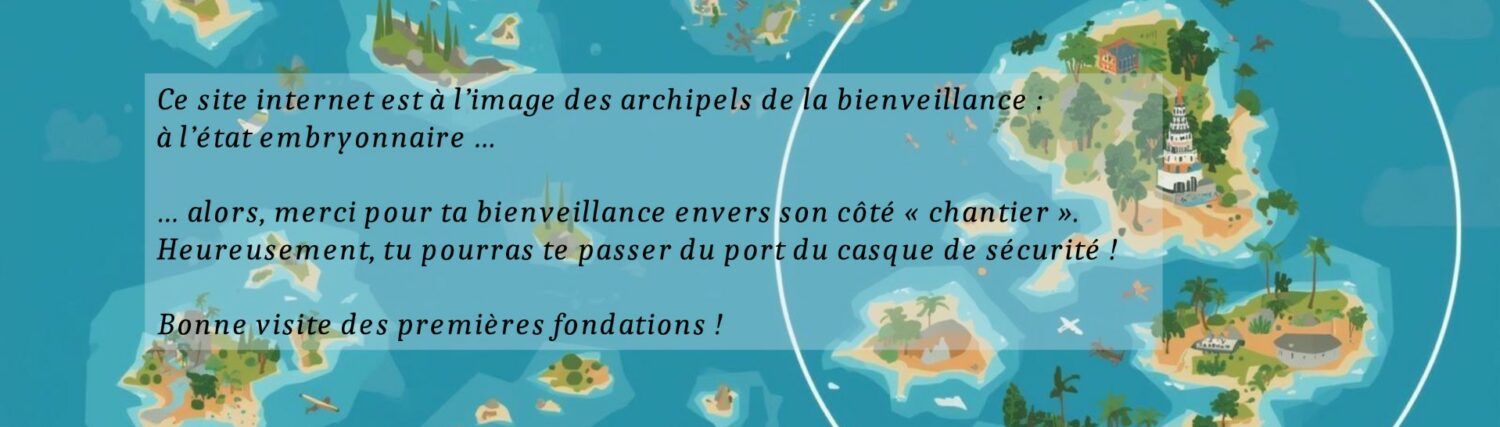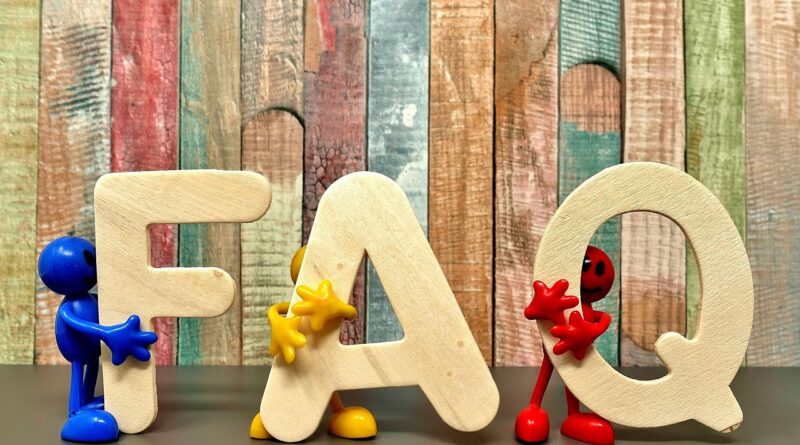
FAQ « Intégrer la bienveillance dans un projet municipal »
Qu’entend-on par « bienveillance » dans le cadre d’une action municipale ?
La bienveillance n’est ni un luxe moral, ni une posture politique. Elle ne se limite pas à la courtoisie ou à la politesse, ni non plus à une vigilance à la non-agression.
C’est une écologie de la relation qui vise à prendre soin de soi, des autres et des écosystèmes humains et non humains.
Elle permet :
De créer un climat de confiance entre élus, agents et citoyens.
De favoriser l’écoute active, la coopération et la résolution non violente des tensions et des conflits.
De prendre soin des vulnérabilités individuelles et collectives, humaines et écologiques.
Comment définir la bienveillance comme écologie de la relation ?
L’écologie de la relation est une approche qui étend le concept d’écologie au-delà de la seule dimension environnementale.
Cette approche qui considère 3 niveaux de relations indissociables et interdépendantes :
La relation à soi : cultiver l’attention à ses émotions, ses limites, ses besoins, son niveau d’engagement dans la commune et les impacts sur sa santé et ses autres sphères de vie, et notamment la vie familiale et affective.
La relation à autrui : reconnaître l’altérité, pratiquer l’empathie, favoriser le dialogue.
La relation aux écosystèmes : respecter le vivant, humain et non humain, dans une logique de cohabitation et de réciprocité, et en considérant l’impact des décisions sur le vivant et sur les générations futures
Intégrer la bienveillance dans cette écologie, c’est reconnaître que des relations saines et respectueuses sont la base d’une communauté résiliente et d’un environnement préservé.
Pourquoi parler de « bienveillance » en politique locale ?
Parce que la commune est le lieu de vie le plus proche des habitants. Y intégrer la bienveillance permet :
de renforcer la confiance citoyenne et l’envie de participer,
de prévenir les conflits (gestion des tensions avant qu’elles se transforment en conflits) et favoriser la médiation,
de développer une démocratie relationnelle tout autant qu’une démocratie représentative,
de garantir que les décisions prennent soin du tissu social et écologique local, en favorisant la coopération et la coconstruction.
La bienveillance n’est-elle pas une posture naïve ou molle face aux réalités politiques ?
Pas du tout. Bien au contraire.
La bienveillance est une force de transformation. La bienveillance n’est pas synonyme de complaisance, mais plutôt d’exigence.
Elle ne signifie pas tout accepter, mais au contraire :
poser des limites claires sans violence,
résister aux logiques d’exclusion et savoir les dénoncer – avec bienveillance – si besoin,
construire des alternatives durables.
Une politique basée sur la bienveillance n’est pas une politique de la faiblesse, mais une politique de l’intelligence collective.
En favorisant la confiance et la coopération par une recherche de mise en sécurité de nos systèmes nerveux, elle permet de dépasser les oppositions stériles et de trouver des solutions créatives aux problèmes complexes.
Elle réduit les coûts liés aux conflits sociaux et améliore l’acceptabilité des projets, ce qui se traduit par une plus grande efficacité de l’action publique.
C’est un choix politique fort, qui refuse la brutalité et l’autoritarisme, ou même tout simplement une forme d’archaïsme démocratique ou de paternalisme et d’infantilisation comme mode de gouvernance.
Comment la bienveillance peut-elle s'inscrire concrètement dans un projet municipal ?
La bienveillance ne se limite pas à une posture morale, philosophique, ni même à une éthique.
Elle traverse les façons d’observer, de penser, de ressentir, de s’exprimer, de prendre des décisions et d’entrer en actions.
La bienveillance s’intéresse tout à la fois au POURQUOI, au QUOI et au COMMENT on agit. Le déficit de bienveillance provenant souvent d’un sous-investissement du COMMENT par manque de temps et de conscience des impacts des interactions « bâclées ».
Voici quelques exemples d’actions concrètes :
- Dans la vie citoyenne : mise en place de processus de démocratie participative et contributives basés sur l’écoute active, le respect des désaccords et la coconstruction.
- Dans les services publics : formation des agents municipaux à l’écologie intérieure, l’accueil bienveillant, à la médiation et à la gestion non violente des conflits.
- Dans les espaces publics : conception et soutien d’espaces inclusifs (parcs intergénérationnels, bancs partagés, jardins partagés, tiers-lieux) qui favorisent les rencontres et les échanges.
- Dans les politiques sociales : soutien aux initiatives d’entraide locales, mise en place de dispositifs d’aide psychologique pour les plus démunis, lutte contre l’isolement des personnes âgées, prévention et lutte contre les violences de toutes sortes, et notamment faites aux femmes et aux enfants.
- Éducation & jeunesse : promouvoir l’apprentissage de la vie intérieure, de l’empathie, de la coopération dès l’école et du bon usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
- Culture & sport : soutenir les initiatives qui valorisent la diversité, la solidarité et de prévention de toutes les formes de violence.
- Environnement : reconnaître les écosystèmes comme partenaires à protéger, en favorisant des projets respectueux du vivant.
- En terme de projet partagé avec les citoyens : coconception et adoption d’une charte ou d’un manifeste citoyen pour une commune, Territoire de la Bienveillance.
Comment faire de la bienveillance un outil de gouvernance ?
- Dialogue constant : Organiser des rencontres régulières avec les associations, les commerçants, et les habitants pour une co-construction des projets.
- Transparence : Assurer une communication claire et honnête sur les décisions prises et les contraintes.
- Évaluation constructive : Mettre en place des bilans de mi-mandat basés sur l’écoute et l’ajustement, plutôt que sur la simple justification.
- Soutien aux initiatives citoyennes : Dédier un budget participatif significatif aux projets proposés et gérés par les habitants, en les accompagnant avec bienveillance.
Comment intégrer la bienveillance dans la relation avec les écosystèmes non humains ?
Il s’agit de repenser notre rapport à la nature – dont nous faisons tout simplement partie intégrante – en sortant d’une logique de domination et d’exploitation court-termiste.
Concrètement, cela peut se traduire par :
- La protection de la biodiversité : création de corridors écologiques, sanctuaires pour les pollinisateurs, et arrêt des pesticides municipaux.
- L’éducation à la nature : mise en place de programmes pédagogiques pour les enfants (et les adultes, voire par les enfants) sur la faune et la flore locales, création de jardins pédagogiques.
- La promotion d’une agriculture urbaine respectueuse du vivant : soutien aux AMAP et aux initiatives de permaculture en ville.
- La reconnaissance du « droit du vivant » : réflexion sur des chartes ou des statuts locaux qui reconnaissent la valeur intrinsèque des écosystèmes, au-delà de leur simple utilité pour l’homme.
La bienveillance est-elle compatible avec les contraintes budgétaires et réglementaires ?
Oui. Les projets bienveillants ne sont pas nécessairement les plus coûteux.
Elle ne repose pas forcément sur des moyens financiers supplémentaires dans sa dimension de changement de posture. Ils misent davantage sur les ressources humaines et relationnelles.
La bienveillance dans un projet municipal s’intègre dans le POURQUOI, le QUOI et le COMMENT des décisions et des actions.
Elle constitue non pas un impératif, un diktat au-dessus de tout, faisant fi des considérations pragmatiques, budgétaires et réglementaires.
C’est une boussole donnant une direction dont on veut s’écarter le moins possible et pouvoir y revenir si on devait s’en écarter ponctuellement.
Le financement d’actions plus coûteuses peut être optimisé par :
- Le rééquilibrage du budget en faveur des initiatives à fort impact social et environnemental.
- La recherche de subventions auprès d’organismes publics et privés sensibles à ce type d’approche.
- La mobilisation du bénévolat et de l’entraide citoyenne, souvent dynamisée par un projet politique bienveillant et inspirant.
La bienveillance génère des économies en temps, en énergie dépensée et en argent dans la mesure où elle réduit les tensions, les conflits et les effets de la démobilisation.
Comment la bienveillance peut-elle s'appliquer dans le contexte de la crise climatique et sociale ?
Face aux crises, la bienveillance est une boussole. Elle nous rappelle que les solutions ne doivent pas se faire au détriment des plus vulnérables. Par exemple :
- Pour le climat : Développer des politiques de transition écologique inclusives, qui ne pénalisent pas les foyers modestes (ex : aides à la rénovation énergétique).
- Pour le social : Face à l’accroissement des inégalités, renforcer les dispositifs d’aide d’urgence et de soutien psychologique, et favoriser les liens sociaux qui sont un amortisseur essentiel aux chocs.
- Face aux conflits : Utiliser la bienveillance pour désamorcer les tensions et favoriser le dialogue plutôt que l’affrontement.
Quels risques ou résistances peut-on rencontrer ?
La confusion entre bienveillance et naïveté ou complaisante : il faut rappeler qu’elle inclut la fermeté éthique et on peut renvoyer aux tableaux comparant une vision étroite et biaisée de la bienveillance par rapport à la vision d’une Société et de Territoire de la Bienveillance
Le rejet par certains acteurs politiques par méconnaissance ou peur de perte de pouvoir : d’où l’importance de poser un cadre clair et de valoriser les bénéfices.
La difficulté à changer les habitudes : cela demande du temps, de la formation, et du soutien mutuel. Un temps dont il faut noter que celui donné à débuter le cheminement vers plus de bienveillance est largement restitué par celui gagné par le fluidité des relations et des prises de décisions.
Quels bénéfices pour une commune qui intègre la bienveillance ?
Une société locale plus cohésive et résiliente,
La possibilité donnée aux citoyens de plus s’impliquer dans la vie publique, sous des formes et des statuts multiples et complémentaires, selon leurs envies, leurs capacités, leur disponibilité,
Des projets pensés dans une logique de prendre soin (care) du vivant,
Une gouvernance plus apaisée et efficace, car moins centrée sur les rapports de force.
Comment mesurer l’impact d’une politique de bienveillance ?
Par des indicateurs qualitatifs : climat relationnel (élus, agents et habitants), sentiment d’appartenance, confiance dans les institutions.
Par des retours citoyens : enquêtes participatives, ateliers d’écoute, diagnostics sensibles.
Par l’observation de dynamiques locales : coopération inter-associative, initiatives spontanées, résilience collective.